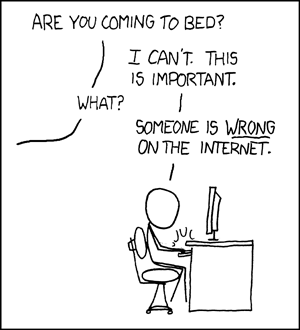Mona Chollet a publié un article intitulé « Oui mais quand même, la religion, c’est mal » – Montée de l’islamophobie et banalisation du fémonationalisme. Étayé par de nombreux éléments pertinents, cet article s’en prend d’abord au recours à l’anti-cléricalisme comme déguisement acceptable pour un rejet qui vise toujours les mêmes : les musulmans, voire les arabes.

à gauche, une militante Femen envoie un signe hostile aux éventuels supporters de l’équipe turque Galatasaray qui voudraient venir soutenir leur équipe à Lviv. La jeune femme qui pose nue, une couronne traditionnelle ukrainienne de fille à marier sur la tête, entourée de deux jeunes hommes aux poings serrés, porte le nom et les couleurs de son club, Karpaty, sur sa peau. Les Femen sont habituées au mélange des genres et aux protestations tous azimuths, mais ici, la revendication était (la photo date de 2010) clairement xénophobe et nationaliste. À droite, des supporters du Galatasaray, équipe actuellement entraînée par une femme, Duygu Erdoğan, situation qui est loin d’être banale dans le monde du football.
Effectivement, les Femens, Caroline Fourest ou Charlie Hebdo, qui se disent en croisade contre toutes les oppressions religieuses, semblent parfois focaliser leur combat sur l’Islam et sur les musulmans, renforçant sciemment ou non les théories de « choc des civilisations » en vogue, et ce en se réclamant de buts louables : liberté, féminisme, humanisme, lutte contre l’homophobie. Leur indignation parait souvent assez sélective. Par exemple, si un musulman commet une horreur en criant « Allah Akbar », ou profère une menace de mort, il représentera, selon certains, un milliard de personnes, tandis qu’un chrétien qui fait quelque chose de semblable se verra présenté comme un fou isolé ou soupçonné d’avoir été conditionné par un groupe sectaire. Ce qui est généralement vrai, du reste, mais pourquoi refuser la même grille d’analyse dès lors qu’il s’agit d’Islam ?
Depuis que les journaux télévisés parlent abondamment d’Islam fondamentaliste (depuis la guerre civile en Algérie, au début des années 1990 ?), on utilise le mot « modéré » pour qualifier tout musulman « normal », et ce mot « modéré » est un poison, car il sous-entend une retenue, une contention, et signifie donc que ce qui n’est pas « fondamentaliste » est, en quelque sorte, tiède, constitue une version diminuée d’une pratique religieuse dont l’essence brute serait l’extrémisme. Le « modéré », c’est celui qui est à deux doigts d’abandonner la foi, si l’on se fie aux écrits des premiers chrétiens comme, sans doute, au Coran. Il faudrait comparer méthodiquement le vocabulaire médiatique employé pour qualifier les fidèles de telle ou telle religion, mais je doute que l’on entende souvent parler de « chrétiens modérés » pour qualifier les gens qui vont à la messe tous les dimanches.
Les leçons d’histoire ou de théologie improvisées par ceux qui jettent un œil rapide à tel ou tel texte relèvent à mon avis de ce que les psychologues nomment le « biais de confirmation » : on croit ce qui va dans le sens de ce qu’on croyait déjà et on ignore ce qui contredit nos préjugés, ou même, on esquive toute occasion de confronter nos préjugés à une réalité opposée.
Entre autres « traitements de faveur » dont bénéficie la civilisation islamique, je trouve ahurissante la manière dont certains ignorants pontifient sur la non-originalité de la science arabe médiévale, qu’ils résument à une simple conservation de l’héritage grec, ignorant l’apport extraordinaire que constituent la médecine, l’astronomie et les mathématiques arabes, notamment. On crédite même le grand physiologiste Ibn Nafis (XIIIe siècle) de l’invention de la science-fiction, avec son roman le Theologus Autodidactus (dont je ne connais pas de traduction française). La science arabe a en réalité énormément pesé sur la naissance de l’université et de la science dans les pays chrétiens, où les velléités de progrès dans le domaine ont longtemps été bridées par les religieux, au nom de leurs certitudes ou de leurs tabous.

La vie de Mahomet, par Charb et Zineb, tome 2. En quatrième de couverture, Charb explique qu’il a été respectueux de l’histoire de Mahomet et s’est interdit tout humour ou recul critique. De fait, le scénario de cette bande dessinée intéressante est une bonne synthèse et ne peut choquer aucun connaisseur du Coran et des Hadiths, si ce n’est que le dessin, par lui-même, induit une distance puisqu’il est intrinsèquement comique — mais il est vrai que ce dessin ne constitue pas un traitement de faveur particulier, puisque Charb dessinera de la même façon n’importe qui. Reste qu’il n’a pas encore fait de « vie de Jésus » ou de « vie de Moïse », et le jour où il le fera, il sera difficile de penser que ça n’aura pas été pour donner le change face à cette critique précise.
On peut aussi créditer l’Islam des origines de l’établissement théorique d’une ébauche de droit des femmes (certes bien imparfait, douze siècles plus tard), ou de l’anti-racisme. Sur ce dernier point, même si des siècles plus tard, des musulmans ont utilisé l’histoire de Noé et de Cham comme prétexte religieux pour justifier la traite des noirs, le prophète avait, lui, pris sous sa protection Bilal l’éthiopien, premier Muezzin, et affirmé à son sujet que l’arabe n’est pas supérieur au non-arabe, que le blanc n’est pas supérieur au noir, si ce n’est par la piété — affirmation qui est bien entendu à double-tranchant et relève du chantage, puisqu’elle impose la conversion à celui qui veut être l’égal de son prochain. L’Islam a aussi théorisé la co-existence avec d’autres religions (enfin avec les deux religions que Mahomet considérait comme ancêtres de la sienne), et plusieurs grands savants arabes sont en fait chrétiens ou juifs, mais ont pu travailler sous la protection de dirigeants musulmans, peu de temps après l’époque où Charlemagne faisait assassiner les non-chrétiens qui avaient le malheur de fouler la terre chrétienne dont il voulait préserver la sainteté. Pour l’anecdote, ce sont les conversions autoritaires et les massacres de païens par Charlemagne qui ont provoqué la colère des paisibles marchands scandinaves, devenus pillards (Vikings) pour quitter leurs fjörds à la belle saison et aller vider les abbayes et les églises situées sur le long de la Seine, de la Loire ou de la Garonne de leurs trésors, activité qui, a provoqué la circulation de fortunes jusqu’ici dormantes, offrant une subite vitalité économique au monde chrétien, devenu grâce à cela suffisamment dynamique pour construire une quantité énorme d’édifices religieux (le fameux « blanc manteau d’églises » évoqué par Raoul le Chauve), mais aussi pour se lancer dans l’aventure des croisades, lesquelles ont, en deux siècles, provoqué la fin de l’âge d’or islamique tout en permettant à la science des pays catholiques de profiter des découvertes des savants arabes. Malgré la prise de Byzance quelques siècles plus tard, le monde musulman a perdu toute la vigueur de ses premiers siècles au terme des croisades, et l’Islam (hors empire Ottoman sans doute) est devenu, dans l’imaginaire des colonisateurs européens en tout cas, la religion du « mektoub », d’une certaine résignation face au destin, une religion tournée vers le passé et les contes de féés (ou de djinns); vaguement soupçonnée d’être associée à des coutumes cruelles et, en tout cas, écartée de toute possibilité de se moderniser — vision des choses bien commodes pour établir la domination condescendante des colons européens. On peut imaginer l’intérêt ou l’espoir que représente, pour de nombreux musulmans, la vigueur et la fierté recouvrées de l’Islam revendicateur qui est né avec la décolonisation et les pétrodollars.
Les vrais historiens trouveront sans doute ma manière de faire le récit de plus d’un millénaire d’histoire humaine un peu cavalière, j’accepte par avance cette critique. Je voulais donner la vision que j’ai des choses pour expliquer que je trouve bien bête ce tweet de Richard Dawkins :

J’aime beaucoup Richard Dawkins pour son Gène égoïste, et pour son invention de l’idée de mème, qui est au monde des idées ce que le gène est au vivant. J’ai bien aimé son God Delusion (Pour en finir avec Dieu, en français) et je ne suis pas gêné par son athéisme militant, je fais même partie de ses centaines de milliers de followers sur Twitter — ceci dit, beaucoup desdits followers sont des adversaires déclarés du biologiste britannique et ne le lisent que pour le couvrir de tombereaux d’insultes ou pour tenter de lui démontrer que Dieu est partout puisqu’il n’est nulle part.
Mais en émettant une vérité cruelle sur le monde musulman, Dawkins n’est plus dans son combat contre l’irationnel, il affirme une supériorité des pays chrétiens sur les pays musulmans, en faisant de l’Islam la cause même de la faible vigueur des universités en sciences dures des pays musulmans.
Or la cause, la vraie, ce sont les croisades et la reconquista, c’est la colonisation, c’est la décolonisation et les régimes autoritaires et nationalistes qui ont été mis en place soit pour permettre cette décolonisation, soit pour qu’elle reste profitable aux ex-colonisateurs, selon les cas.
Quand Dawkins ajoute que le monde musulman tout entier a produit moins de prix Nobels que la seule université de Cambridge, il n’évoque pas le fait que la prospérité britannique s’est construite sur le dos de ses colonies, protectorats, mandats et dominions (autant pour la France, bien sûr, l’autre grand empire colonial). Il ne se demande pas si les régions minières sinistrées de Grande-Bretagne ont produit autant de Nobels que les habitants des beaux quartiers de Londres. Il ne dit pas que le manque d’instruction a été encouragé dans de nombreux pays pour que l’on puisse en spolier les matières premières.
Mettre tous ces problèmes sur le dos d’une religion est un peu court, et l’exprimer par ce genre de phrases déterministes, plutôt insultant et pas vraiment digne de quelqu’un qui représente la science dans l’esprit du public.
L’insulte, le mépris, est bien la grosse erreur que peuvent commettre les athées, qui pensent que leur lucidité vis à vis d’entités divines imaginaires est la garantie chez eux d’une clairvoyance universelle.
Sur ce point, et bien que ce genre d’attitude me vienne facilement, je peux difficilement ne pas rejoindre Mona Chollet.

Le sanctuaire de Lourdes : tais-toi et prie ! (photo : bibi)
Mais en même temps, je persiste à considérer les religions avec hostilité, et notamment les religions monothéistes prosélytes à vocation universelle et exclusive, à savoir le Christianisme et l’Islam.
En tant que systèmes de croyances, ces religions ne me gênent pas énormément : si les gens ont envie de croire que les hosties transsubstantiaionnent ou qu’il faut embrasser un aérolithe enfermé dans un cube géant après avoir effectué sept circumambulations pour faire pardonner ses pêchés, très bien. Mais une religion n’est pas qu’une somme de croyances, c’est aussi un outil de domination. On remarque que les dieux, et notamment les dieux uniques, que l’on ne peut contester puisqu’ils n’ont pas de concurrents, ont toujours des exigences précises sur les détails de la vie : mange pas ci ! debout ! fais pas ça ! assis ! porte ce chapeau : couché ! De manière assez rusée, les ordres les plus irrationnels sont enrobés dans une morale de bon sens (il ne faut pas tuer et ne pas voler) qui n’a évidemment besoin d’aucun support surnaturel irrationnel pour exister, mais que les religieux parviennent à faire ensuite passer pour leur invention — je suis toujours épaté par le nombre de non-croyants qui voient la religion comme un mal nécessaire pour inculquer une moralité aux esprits faibles. La morale n’a jamais eu besoin de Dieux, et au contraire, les Dieux sont souvent prompts à proposer des amendements à la morale élémentaire : ne mens pas, sauf à l’infidèle ; ne tue pas, sauf le mahométan ; ne vole pas ton prochain, mais pille les richesses des païens ; tous les hommes sont égaux, sauf ceux qui n’embrassent pas la même foi que toi.
Par les rites qui ponctuent l’existence, les religions servent à souder les sociétés, à relier les gens autour d’un système de croyances et de pratiques (y compris pratiques sociales, comme le degré de pudeur et les formules de politesse, ou encore les pratiques relatives à l’hygiène), et cela explique qu’il soit si difficile d’y renoncer, mais cela explique aussi que des religions théoriquement universelles puissent si facilement devenir un support au nationalisme ou au communautarisme — il existe des gens qui croient sincèrement que leur dieu veut faire gagner leur équipe de football, quand bien même il est aussi le dieu de l’équipe adverse. Dans l’idée de certains, dieu n’est que le principe immatériel et improbable qui fait exister une communauté en tant que telle. On peut être chrétien sans le moindre résidu de foi, mais parce qu’on ne s’imagine pas renoncer au mariage religieux, au baptême ou aux offices funèbres, et qui bien entendu fêtent Noël ou achètent des cadeaux à Pâques. Je connais aussi des musulmans qui ne pratiquent pas leur religion, qui se décrivent comme agnostiques (manière polie de dire qu’on est athée, bien souvent) mais qui font le Ramadan, soit pour faire plaisir à leurs parents, soit par habitude, soit parce que la fête qui suit la rupture de jeûne n’a pas de sens sans jeûne, ou quelque chose comme ça. Je me souviens de l’histoire d’une fille qui mangeait une barre chocolatée dans la rue et qui a reçu une lourde claque de la part d’un inconnu qui l’a au passage traitée de prostituée parce qu’elle osait manger pendant le Ramadan. Cet homme avait jugé que la jeune femme, d’origine maghrébine, devait se conformer à la contrainte religieuse, parce qu’elle était, pour reprendre le mot si décrié de Nicolas Sarkozy, « d’apparence musulmane ». On voit dans cette histoire que la religion n’est pas pas qu’une affaire intime de foi et d’adhésion individuelle, mais bien aussi un outil pour constituer les identités communautaires, au détriment de l’identité individuelle.

En cas de grosse demande, il faut brûler un gros cierge à 150 euros (Lourdes, le sanctuaire, photo bibi).
C’est parce que la religion est rarement un véritable choix intellectuel qu’il faut s’en défier — si l’on chérit la liberté, et notamment sa propre liberté —, mais c’est aussi pour cette raison, paradoxalement, qu’il faut la respecter, parce que les croyants considèrent leur religion comme une partie d’eux-mêmes, qu’ils aient été convertis de fraîche date ou qu’ils héritent leur foi de leurs ancêtres. On ne fera jamais de mal à un dieu en l’insultant, ce sont ses fidèles qui prennent l’insulte pour eux, qui en sont fâchés ou qui se sentent humiliés. Par ailleurs, en disant à des croyants des vérités sur leurs dieux, on fait les affaires de leurs prêtres, qui savent que le martyre, la censure ou l’interdiction éprouvées, le crachat ou l’insulte reçus, sont autant d’outils de communication, de conversion ou de renforcement de la foi. Du reste, ce qui peut rendre l’Islam dangereux, ce n’est pas la fantaisie de ses textes fondateurs (lisez les autres, vous m’en direz des nouvelles) ni des croyances associées, mais bien le constant sentiment d’humiliation que ressentent ses adeptes, sentiment qui est justement provoqué par le manque d’estime ou de sympathie avec lequel on les traite.
Bref bref bref, la religion n’est pas toujours un bienfait, elle n’est pas logique, elle n’est pas fondée, mais il faut faire avec, sans pour autant se laisser trop faire. Ce n’est pas forcément incompatible, c’est un équilibre à trouver.